Voici deux semaines que le conflit social autour de la réforme des retraites s'est emballé. Alors que la loi de vrait être votée dans deux ou trois jours par le Parlement, un premier bilan peut être esquissé. Certes, le mouvement est loin d'être terminé, les blocages de raffinerie, malgré les réquisitions des pouvoirs publics, se poursuivent, entraînant une pénurie partielle de carburant. Mais, on sent bien, à la faveur des vacances scolaires, très opportunes pour le pouvoir, et la fin du feuilleton législatif, que la protestation sociale va baisser d'un niveau. Que retenir de cette rentrée sociale particulièrement agitée? Trois enseignements peuvent être tirés:
vrait être votée dans deux ou trois jours par le Parlement, un premier bilan peut être esquissé. Certes, le mouvement est loin d'être terminé, les blocages de raffinerie, malgré les réquisitions des pouvoirs publics, se poursuivent, entraînant une pénurie partielle de carburant. Mais, on sent bien, à la faveur des vacances scolaires, très opportunes pour le pouvoir, et la fin du feuilleton législatif, que la protestation sociale va baisser d'un niveau. Que retenir de cette rentrée sociale particulièrement agitée? Trois enseignements peuvent être tirés:
1/ Le pouvoir n'a rien cédé.
En France, il est tout à fait nouveau qu'un mouvement social aussi important dans la durée et par la mobilisation populaire (sans doute plus de cinq millions de personnes ont, à un moment ou un autre, manifesté contre le projet de loi) ne donne aucun débouché politique. Le joli mois de mai (68) s'était traduit par des accords sociaux importants (sur les comités d'entreprises, la revalorisation des salaires) sans oublier la réforme de l'université. L'importante mobilisation des cheminots en 1995 avait conduit à l'abandon du projet de réforme des régimes spéciaux pour les retraites (déjà!). Le mouvement anti-CPE de 1996 avait abouti à sa non-application, malgré l'adoption du Contrat première embauche par le Parlement. Cette fois-ci, à part de très minces aménagements pour les mères de famille et les parents d'enfants handicapés, le pouvoir n'a rien lâché. On pouvait, par exemple, penser qu'il a lâché du lest sur le départ à 67 ans pour les personnes qui ont eu des carrières en dent de scie car il apparaissait choquant que des travailleurs déjà peu gâtés par la vie dussent trimer si longtemps. Dans une posture à la Thatcher, le Président a affiché sa détermination, imposant même au Sénat si jaloux de son indépendance, une accélération de l'examen du texte. Est-ce que cette fermeté sera analysée comme un élément positif, traduisant une capacité à résister à la pression extérieure, ou, au contraire, comme un entêtement fâcheux synonyme de refus de dialoguer? Il est encore trop tôt pour répondre à cette question, mais on observera qu'au moment le plus critique – montée de la pénurie d'essence, mobilisation massive des lycéens avec ici ou là des débordements ultra-violents – les Français ont continué à exprimer un soutien très large à ces grèves qui, pourtant, compliquaient les conditions de vie des gens, en compromettant certains départs en vacances.
2/ Le mouvement social est resté uni de bout en bout.
Même si la fin de conflit pourrait se faire dans la désunion, on notera que pour la première fois depuis bien longtemps, le front syndical est resté soudé, malgré les différences évidentes de sensibilité, par exemple entre Solidaires et la CFDT. Cette centrale qui n'a reçu aucun gage de la part du pouvoir a fait le choix du conflit jusqu'au bout, ce qui marque une vraie évolution dans la culture cédétiste sensible à l'idée du compromis. Le pouvoir aura donc réussi à radicaliser le syndicat le plus réformiste et à ne pas isoler les éléments les plus radicaux qui, par leur attitude responsable, ont gagné en crédibilité. Le pouvoir espérait par ailleurs exacerber les tensions au sein de la CGT entre une direction plutôt ouverte au compromis et privilégiant un accord solide avec la CFDT et certaines fédérations prêtes à en découdre et à se rapprocher de SUD. Sauf évolution de dernière heure, il n'en a rien été et cela marque un échec pour la stratégie de division tentée par le pouvoir sarkozyste. A l'avenir, toute volonté de réforme jugée libérale sera sévèrement combattue par un front syndical qui, malgré sa défaite sur le papier, a marqué des points pendant ces semaines de mobilisation.
depuis bien longtemps, le front syndical est resté soudé, malgré les différences évidentes de sensibilité, par exemple entre Solidaires et la CFDT. Cette centrale qui n'a reçu aucun gage de la part du pouvoir a fait le choix du conflit jusqu'au bout, ce qui marque une vraie évolution dans la culture cédétiste sensible à l'idée du compromis. Le pouvoir aura donc réussi à radicaliser le syndicat le plus réformiste et à ne pas isoler les éléments les plus radicaux qui, par leur attitude responsable, ont gagné en crédibilité. Le pouvoir espérait par ailleurs exacerber les tensions au sein de la CGT entre une direction plutôt ouverte au compromis et privilégiant un accord solide avec la CFDT et certaines fédérations prêtes à en découdre et à se rapprocher de SUD. Sauf évolution de dernière heure, il n'en a rien été et cela marque un échec pour la stratégie de division tentée par le pouvoir sarkozyste. A l'avenir, toute volonté de réforme jugée libérale sera sévèrement combattue par un front syndical qui, malgré sa défaite sur le papier, a marqué des points pendant ces semaines de mobilisation.
3/ La gauche a été très présente, mais pas toujours convaincante.
De bout en bout, les partis de gauche ont collé au mouvement social, participant à toutes les manifestations et ne faisant aucun commentaire sur la gestion du conflit. C'est la preuve d'un vrai respect de l'autonomie des militants syndicaux. Pour autant, la gauche est restée peu loquace sur les solutions qu'elle propose pour sauver les retraites. Celle-ci a louvoyé entre une négation du problème (certains affirmant que la question démographique n'est pas si grave que cela...position irresponsable) et le flou autour des propositions. On n'a toujours pas compris si le PS est favorable à l'allongement de la durée de cotisation (ce qui semble être la position majoritaire) ou au maintien du nombre d'annuités avant les réformes Balladur-Fillon. La radicalité de l'affrontement entre la rue et le pouvoir a masqué le manque de clarté de la gauche sur cette question. Certains objecteront que le PS a élaboré un contre-projet, mais on s'étonnera tout de même qu'il ne l'ait pas mis plus en avant. Sans doute parce qu'il aurait été jugé trop modéré par un mouvement social dont une partie a décidé, dans un élan de générosité pas toujours responsable, de faire fi de toutes les contraintes de l'environnement international. Le retour sur terre risque d'être un peu difficile...
 Dans l'interview qu'a donnée Bertrand Delanoë au journal Le Monde (16 juin), une phrase a retenu mon attention. Non pas celle – relevée par certains journalistes – où il répond à la question « Avez-vous fait une croix sur vos ambitions au sein du PS? » par un « je n'ai fait une croix sur rien du tout ». Imagine-t-on qu'à cette question, le maire de Paris réponde tranquillement: « Oui, après mon échec à conquérir le PS à l'automne dernier, j'entends me consacrer entièrement à ma ville et après 2014, je prendrai ma retraite dans ma Tunisie natale et quitterai la politique »? Même s'il ne croit plus à son destin présidentiel – je n'en sais fichtrement rien -, il ne dira rien de définitif qui lui reviendrait ensuite comme une boomerang. Ne jamais injurier l'avenir, c'est une règle en politique qu'un jour d'avril 2002, Lionel Jospin, pris par un élan de sincérité et d'éthique démocratique, avait oublié. Il s'en est bien mordu les doigts ensuite.
Dans l'interview qu'a donnée Bertrand Delanoë au journal Le Monde (16 juin), une phrase a retenu mon attention. Non pas celle – relevée par certains journalistes – où il répond à la question « Avez-vous fait une croix sur vos ambitions au sein du PS? » par un « je n'ai fait une croix sur rien du tout ». Imagine-t-on qu'à cette question, le maire de Paris réponde tranquillement: « Oui, après mon échec à conquérir le PS à l'automne dernier, j'entends me consacrer entièrement à ma ville et après 2014, je prendrai ma retraite dans ma Tunisie natale et quitterai la politique »? Même s'il ne croit plus à son destin présidentiel – je n'en sais fichtrement rien -, il ne dira rien de définitif qui lui reviendrait ensuite comme une boomerang. Ne jamais injurier l'avenir, c'est une règle en politique qu'un jour d'avril 2002, Lionel Jospin, pris par un élan de sincérité et d'éthique démocratique, avait oublié. Il s'en est bien mordu les doigts ensuite.
 lques jours, les euro-députés prendront leurs fonctions à Bruxelles et Strasbourg. Pour la France, ce sont 72 parlementaires désignés par 40 % du corps électoral (ne l'oublions jamais!). Nul besoin de rappeler les équilibres politiques avec un groupe UMP supérieur d'une unité au total PS + Europe écologie (EE), 29 élus pour le premier cas et deux fois 14 pour les seconds. On rajoutera les 6 députés MoDem, les 5 du Front de gauche, les 3 du FN et le dernier de Libertas, Philippe de Villiers. La liste devrait évoluer car Jean-François Kahn, tête de liste MoDem dans l'Est, a déjà annoncé qu'il céderait la place à la seconde de liste, députée sortante, alors que Brice Hortefeux, élu à la surprise générale dans le Centre, ne devrait pas suivre à Bruxelles ses collègues Michel Barnier et Rachida Dati, pour rester au gouvernement, ce qui permettra à une femme de siéger au Parlement européen.
lques jours, les euro-députés prendront leurs fonctions à Bruxelles et Strasbourg. Pour la France, ce sont 72 parlementaires désignés par 40 % du corps électoral (ne l'oublions jamais!). Nul besoin de rappeler les équilibres politiques avec un groupe UMP supérieur d'une unité au total PS + Europe écologie (EE), 29 élus pour le premier cas et deux fois 14 pour les seconds. On rajoutera les 6 députés MoDem, les 5 du Front de gauche, les 3 du FN et le dernier de Libertas, Philippe de Villiers. La liste devrait évoluer car Jean-François Kahn, tête de liste MoDem dans l'Est, a déjà annoncé qu'il céderait la place à la seconde de liste, députée sortante, alors que Brice Hortefeux, élu à la surprise générale dans le Centre, ne devrait pas suivre à Bruxelles ses collègues Michel Barnier et Rachida Dati, pour rester au gouvernement, ce qui permettra à une femme de siéger au Parlement européen. s, le frontiste Jean-Marie Le Pen, 80 balais. Là aussi, des différences sont sensibles d'un groupe à l'autre : autour de la moyenne, l'UMP (54 ans); en-dessous, le PS (52 ans) et EE (50 ans); au-dessus, le MoDem et le Front de gauche (56 ans), le FN (60 ans). On remarquera que la tranche d'âge 20-30 ans est représentée par 2 élus (UMP, EE), celle des 30-40 ans par 5 députés (2 UMP, 1 PS, 2 EE) alors que celle des 60-70 l'est par 17 députés (11 UMP, 2 PS, 3 EE, 1 Libertas). Ce n'est bien sûr pas la raison principale, mais il est clair que de nombreux jeunes ont du mal à se sentir représentés, au niveau générationnel, par des élus qui ont très souvent l'âge d'être leurs parents voire leurs grands-parents.
s, le frontiste Jean-Marie Le Pen, 80 balais. Là aussi, des différences sont sensibles d'un groupe à l'autre : autour de la moyenne, l'UMP (54 ans); en-dessous, le PS (52 ans) et EE (50 ans); au-dessus, le MoDem et le Front de gauche (56 ans), le FN (60 ans). On remarquera que la tranche d'âge 20-30 ans est représentée par 2 élus (UMP, EE), celle des 30-40 ans par 5 députés (2 UMP, 1 PS, 2 EE) alors que celle des 60-70 l'est par 17 députés (11 UMP, 2 PS, 3 EE, 1 Libertas). Ce n'est bien sûr pas la raison principale, mais il est clair que de nombreux jeunes ont du mal à se sentir représentés, au niveau générationnel, par des élus qui ont très souvent l'âge d'être leurs parents voire leurs grands-parents. ts -, il est difficile de les comptabiliser tellement ils sont nombreux.
ts -, il est difficile de les comptabiliser tellement ils sont nombreux.
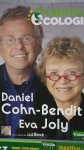 Le scrutin de ce dimanche dans notre hexagone est assez clair. C'est la règle des 2/2. Deux gagnants et deux perdants. Un petite victoire pour l'UMP qui a surfé sur l'image très positive laissée par la présidence française de super-Sarkozy, et une grande victoire pour les listes Europe écologie emmenées par le toujours vert Daniel Cohn-Bendit.
Le scrutin de ce dimanche dans notre hexagone est assez clair. C'est la règle des 2/2. Deux gagnants et deux perdants. Un petite victoire pour l'UMP qui a surfé sur l'image très positive laissée par la présidence française de super-Sarkozy, et une grande victoire pour les listes Europe écologie emmenées par le toujours vert Daniel Cohn-Bendit.
