L'un des principaux enseignements de ce scrutin présidentiel a été la très forte progression de Marine Le Pen essentiellement dans les zones rurales profondes, là où l'insécurité "physique" et la forte immigration ne sont que des choses "vues à la télé". De nombreuses analyses ont tenté d'expliquer ce phénomène, de façon plus ou moins pertinente. La question de l'isolement, le sentiment de ne plus comprendre les évolutions d'un monde qui va de plus en plus vite ont été soulevés, tout comme des éléments plus objectifs comme la misère sociale et culturelle, l'explosion du prix du carburant (particulièrement sensible quand on vit à 30 km du chef-lieu).
 La Mayenne est un bon exemple de cette percée. Dans ce département de l'Ouest rural (300 000 habitants), marqué par le cléricalisme puis par la démocratie-chrétienne, Marine Le Pen a réalisé le 22 avril près de 15 % des voix (27 000 voix), derrière Sarkozy (30 %) et Hollande (26 %), mais devant Bayrou soutenu pourtant par le président du conseil général et sénateur influent, Jean Arthuis. En 2007, son père avait réalisé 14 000 voix (7,5 %) et 19 000 en 2002 (11,5 %). En dix ans, le porte-drapeau des thèses d'extrême droite a gagné plus de 8 000 voix et 13 000 par rapport à 2007 (alors que la participation était supérieure voici 5 ans). Cette évolution est générale dans l'Ouest : en Vendée, terre aux caractéristiques assez voisines, le FN est passé en cinq ans de 6,5 % à 15 % des voix. Dans l'Orne, voisine de la Mayenne, un territoire encore plus rural, le vote Le Pen est passé de 12 à 20 % (au-dessus donc de la moyenne nationale).
La Mayenne est un bon exemple de cette percée. Dans ce département de l'Ouest rural (300 000 habitants), marqué par le cléricalisme puis par la démocratie-chrétienne, Marine Le Pen a réalisé le 22 avril près de 15 % des voix (27 000 voix), derrière Sarkozy (30 %) et Hollande (26 %), mais devant Bayrou soutenu pourtant par le président du conseil général et sénateur influent, Jean Arthuis. En 2007, son père avait réalisé 14 000 voix (7,5 %) et 19 000 en 2002 (11,5 %). En dix ans, le porte-drapeau des thèses d'extrême droite a gagné plus de 8 000 voix et 13 000 par rapport à 2007 (alors que la participation était supérieure voici 5 ans). Cette évolution est générale dans l'Ouest : en Vendée, terre aux caractéristiques assez voisines, le FN est passé en cinq ans de 6,5 % à 15 % des voix. Dans l'Orne, voisine de la Mayenne, un territoire encore plus rural, le vote Le Pen est passé de 12 à 20 % (au-dessus donc de la moyenne nationale).
A une vingtaine kilomètres de Laval, ma mère Madeleine Bouttier, militante socialiste chevronnée, est partie à la rencontre des habitants pour les convaincre de vot er "François Hollande". Elle a ciblé les petits îlots de logements HLM qui se sont construits dans ces communes rurales et qui abritent des personnes très défavorisées. Chez ces personnes très peu politisées, elle ne s'est pas contentée d'un "bonjour. je représente le candidat..." et de donner un tract qui finira rapidement à la poubelle, mais a pris le temps de discuter avec tous ceux qui souhaitaient engager la discussion. Parmi eux, évidemment des électeurs de Marine Le Pen. Elle a couché sur le papier cette plongée dans une France de peu et d'amer. Je publie donc son témoignage qui vaut bien de longs développements.
er "François Hollande". Elle a ciblé les petits îlots de logements HLM qui se sont construits dans ces communes rurales et qui abritent des personnes très défavorisées. Chez ces personnes très peu politisées, elle ne s'est pas contentée d'un "bonjour. je représente le candidat..." et de donner un tract qui finira rapidement à la poubelle, mais a pris le temps de discuter avec tous ceux qui souhaitaient engager la discussion. Parmi eux, évidemment des électeurs de Marine Le Pen. Elle a couché sur le papier cette plongée dans une France de peu et d'amer. Je publie donc son témoignage qui vaut bien de longs développements.
« La première séquence de porte-à-porte, avant le premier tour, m'a laissé dubitative. Mis à part quelques personnes refusant de nous écouter, nous avons été bien accueillis, certains se défoulant, avec des "vivement qu'on le mette à la porte, ce petit coq", d'autres se disant bien informés, d'autres, enfin, nous écoutant poliment.
Première commune: inscrits 340, exprimés 290, Le Pen 79 voix (27,24 %). Première porte : "Je suis volontaire pour la campagne de François Hollande, je passe vous voir pour répondre à vos questions, vous écouter..." Une jeune femme: "Si j'avais une seule raison de voter Hollande, c'est pour la retraite, mon père est usé, il a commencé à travailler jeune pour qu'il ait la retraite à 60 ans." Sa mère: "Je suis au chômage. Sarkozy a rien fait pour nous." L'homme jeune, présent, n'a rien dit.
Dans un garage, trois hommes discutent autour d'une anisettes. Des ouvriers du bâtiment, l'un la soixantaine, le second de 30 ans et l'autre de 40 ans. Discours du Front national. J'entends leurs récriminations : "le taxi qui n'est plus remboursé pour aller voir le chirurgien qui l'a opéré." "l'étranger qui a plus d'avantages sociaux que l'étranger", "le bougnoule"... Dans la discussion, ils glissent : "Sarko, c'est les riches et Hollande, c'est le social."
A une autre porte, un homme m'ouvre : "Non, non, mon choix est fait; ils sont tous pareils." Une autre femme, jeune, n'est pas inscrite ; a déménagé récemment. Une femme, la cinquantaine bien sonnée : "Je voterai Hollande, je suis ouvrière, c'est normal." Une autre femme fera le même choix : "Ras-le-bol de Sarko. Tout ce qu'il a promis et n'a pas fait." Un homme au visage haineux : "ça ne m'intéresse pas" et me ferme la porte au nez.
Un couple, la quarantaine, m'ouvre. L'homme : "Parlez avec ma femme, c'est ma femme qui s'en occupe". "Il ne vote pas", me dit-elle. Elle a des questions: "Est-il vrai que les étrangers auront le droit de vote?" J'explique pourquoi, à quelles conditions, les limites, les autres pays européens où ce droit de vote existe. Elle écoute et est visiblement intéressée. Des enfants qui jouaient dehors arrivent. Elle me dit en riant: "Ils en parlent à l'école et me disent qu'il faut voter Hollande car Sarkozy a supprimé beaucoup d'enseignants". J'embraye sur la justice sociale ; je crois l'avoir convaincu. Le mari, dans l'escalier, écoutait. Je lui dis : "Pourquoi ne votez-vous pas?" "ça ne m'intéresse pas", me répond-il. Je lui dis: "Bientôt, votre fille vous convaincra de voter". Je repense à ce que m'avait dit une jeune Lavalloise ayant fait du porte-à-porte avec moi : "Mes parents ne votaient pas ; cette année, ils vont le faire. C'est l'école qui m'a fait découvrir les enjeux."
Dans ma commune, je recommence l'opération dans les HLM de mon voisinage. Une famille avec 5 enfants accepte de me faire rentrer. Là aussi, c'est la femme qui participe aux échanges. Elle ne veut plus de Sarkozy, son mari ne vote pas, complètement en marge, ne retrouve pas de travail, son RSA a été supprimé parce que, me disent-ils, sa femme distribue Ouest-France le matin dans deux communes et ils ont trop de revenus. Les questions portent sur l'emploi, l'école... La femme suit à la télé la campagne.
Le lendemain, je propose à une femme que je rencontre au chalet d'échanges et de savoirs d'aller chez elle pour parler des présidentielles. Elle accepte et je lui demande d'inviter une autre femme qui suit aussi les activités d'insertion. D'emblée, la seconde, plus âgée, me dit : "C'est secret ce qu'on a voté." Mais à ces questions, elle se trahit. "Est-ce vrai que les étrangers prennent notre travail?; "Pourquoi certains viennent à la banque alimentaire avec de belles voitures?" "Il parait que des jeunes viennent deux jours au travail et qu'ils ne reviennent pas." "Il parait que le tueur de Toulouse était connu de la police, mais c'est à cause des juges qu'on l'a relâché." Pendant une heure et demie, j'explique les heures supplémentaires défiscalisées, le contrat de génération de Hollande, les problèmes d'effectif dans la police et la justice... Je leur conseille aussi de regarder d'autres chaînes que la Une. Et je fais de l'instruction civique en répondant à leurs questions : "Et si je mets un bulletin de chacun dans l'enveloppe, est-ce que cela comptera pour chacun?" "Comment faire pour voter à la place de quelqu'un?" "comment ça se passe pour compter les voix?"
Une "tracteuse" m'a rapporté ces réactions de deux ouvriers agricoles : "Les politiques ne nous regardent plus, ils nous méprises, nous comptons pour rien" "Sarko fait ce qu'il peut, mais y'a la crise" (cette personne ne regarde que TF1). »
 ement dans son éditorial? Le risque, pourtant, est de rester trop imprégné du souvenir de la première victoire de la gauche sous la Ve République et de croire que l'histoire se répète...
ement dans son éditorial? Le risque, pourtant, est de rester trop imprégné du souvenir de la première victoire de la gauche sous la Ve République et de croire que l'histoire se répète...
 compte-goutte et les traditions politiques familiales était une réalité rarement contestée. Aujourd'hui (il suffisait, pour s'en convaincre, de regarder l'assemblée à la Bastille), la société est très multicolore, très métissée, l'information (le meilleur comme le pire) circule plus vite que la lumière et une partie importante des citoyens ne sent pas appartenir à une famille politique.
compte-goutte et les traditions politiques familiales était une réalité rarement contestée. Aujourd'hui (il suffisait, pour s'en convaincre, de regarder l'assemblée à la Bastille), la société est très multicolore, très métissée, l'information (le meilleur comme le pire) circule plus vite que la lumière et une partie importante des citoyens ne sent pas appartenir à une famille politique. 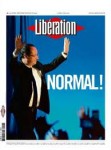 s est totalement exceptionnelle. L'Europe est menacée d'implosion, le couple franco-allemand risque d'aller dans les prochaines semaines, la zone euro craque de toutes parts, les « marchés » comme on dit sont aux aguets, prêts à sanctionner toute audace économique. Et puis ne parlons même du chômage qui pourrait s'envoler dans les prochains mois, de l'endettement qui pèse lourdement sur nos épaules et le spectre de la pauvreté qui plane sur des franges de plus en plus larges de la population française. Là encore, rien à voir avec la France qui sortait des 30 glorieuses et qui croyait en la reprise de la croissance...
s est totalement exceptionnelle. L'Europe est menacée d'implosion, le couple franco-allemand risque d'aller dans les prochaines semaines, la zone euro craque de toutes parts, les « marchés » comme on dit sont aux aguets, prêts à sanctionner toute audace économique. Et puis ne parlons même du chômage qui pourrait s'envoler dans les prochains mois, de l'endettement qui pèse lourdement sur nos épaules et le spectre de la pauvreté qui plane sur des franges de plus en plus larges de la population française. Là encore, rien à voir avec la France qui sortait des 30 glorieuses et qui croyait en la reprise de la croissance... de campagne électorale, depuis l'entrée officielle en campagne du président sortant (voir mon post du 15 février). Essayons de baliser le champ de réflexion autour de trois grandes interrogations.
de campagne électorale, depuis l'entrée officielle en campagne du président sortant (voir mon post du 15 février). Essayons de baliser le champ de réflexion autour de trois grandes interrogations. çois Hollande au premier tour, mais c'est en grande partie dû à l'élimination de concurrents potentiels comme Hervé Morin, Christine Boutin ou Dominique de Villepin (les deux premiers s'étant ralliés au candidat UMP). De plus, son discours ultra-droitier lui aurait permis de grignoter quelques voix tentées par Marine Le Pen, alors que le positionnement mal compris de François Bayrou lors du drame de Toulouse (il avait continué à faire campagne comme si de rien n'était et estimé que la dérive de Merah était le fruit de la société) aurait amené certains de ses supporters à lui préférer la posture présidentielle de Nicolas Sarkozy.
çois Hollande au premier tour, mais c'est en grande partie dû à l'élimination de concurrents potentiels comme Hervé Morin, Christine Boutin ou Dominique de Villepin (les deux premiers s'étant ralliés au candidat UMP). De plus, son discours ultra-droitier lui aurait permis de grignoter quelques voix tentées par Marine Le Pen, alors que le positionnement mal compris de François Bayrou lors du drame de Toulouse (il avait continué à faire campagne comme si de rien n'était et estimé que la dérive de Merah était le fruit de la société) aurait amené certains de ses supporters à lui préférer la posture présidentielle de Nicolas Sarkozy.  èse de Nicolas Sarkozy, d'autant que celui-ci a été la caricature de lui-même. Jusqu'à son affiche officielle, le candidat socialiste campe assez efficacement le portrait du président de rechange. Pour autant, a-t-il convaincu qu'il avait un vrai dessein pour le pays ? On a du mal à répondre positivement à cette question. Certes, il a mis l'accent assez justement sur la priorité à la jeunesse et à l'éducation ; il semble sensible aux dimensions éthiques de l'exercice politique ; il garde un oeil sur l'état des finances publiques.
èse de Nicolas Sarkozy, d'autant que celui-ci a été la caricature de lui-même. Jusqu'à son affiche officielle, le candidat socialiste campe assez efficacement le portrait du président de rechange. Pour autant, a-t-il convaincu qu'il avait un vrai dessein pour le pays ? On a du mal à répondre positivement à cette question. Certes, il a mis l'accent assez justement sur la priorité à la jeunesse et à l'éducation ; il semble sensible aux dimensions éthiques de l'exercice politique ; il garde un oeil sur l'état des finances publiques.  tes, mais rarement confrontent ces données avec des études sérieuses, avec des chiffrages indépendants. « Le Canard enchaîné » de cette semaine propose ce travail de déconstruction particulièrement éclairant. Il nous apprend aussi les approximations du candidat sortant. Par exemple, sur le RSA, il escompte en durcissant les contrôles sur 1 milliard d'euros d'économies alors que, comme le rappelle le balmipède, « 1,7 million des pauvres qui y ont droit ne l'ont pas encore réclamée. S'ils se réveillaient, il en coûtera au moins 5 milliards de plus à l'Etat.
tes, mais rarement confrontent ces données avec des études sérieuses, avec des chiffrages indépendants. « Le Canard enchaîné » de cette semaine propose ce travail de déconstruction particulièrement éclairant. Il nous apprend aussi les approximations du candidat sortant. Par exemple, sur le RSA, il escompte en durcissant les contrôles sur 1 milliard d'euros d'économies alors que, comme le rappelle le balmipède, « 1,7 million des pauvres qui y ont droit ne l'ont pas encore réclamée. S'ils se réveillaient, il en coûtera au moins 5 milliards de plus à l'Etat.  e sur deux partant à la retraite. Quant à Jean-Luc Mélenchon, l'hebdo satirique note la folie des grandeurs de son programme. Par exemple, le remboursement à 100 % des ftais de santé coûterait la bagatelle de 76 milliards d'euros. Mais là, d'une certaine manière, les chiffres importent peu puisque le porte-drapeau du Front de gauche ne pense pas, même dans le plus fou de ses rêves, gouverner un jour.
e sur deux partant à la retraite. Quant à Jean-Luc Mélenchon, l'hebdo satirique note la folie des grandeurs de son programme. Par exemple, le remboursement à 100 % des ftais de santé coûterait la bagatelle de 76 milliards d'euros. Mais là, d'une certaine manière, les chiffres importent peu puisque le porte-drapeau du Front de gauche ne pense pas, même dans le plus fou de ses rêves, gouverner un jour. finalistes seront Hollande et Sarkozy, il reste bien des points d’interrogation, aussi bien sur l’ordre d’arrivée des candidats que sur la tournure que prendra le second tour.
finalistes seront Hollande et Sarkozy, il reste bien des points d’interrogation, aussi bien sur l’ordre d’arrivée des candidats que sur la tournure que prendra le second tour. enger, même s’il a rattrapé une partie de celui-ci. Etre à 44 ou 45 % des voix du second tour, à cinq semaines de celui-ci, ne s’est jamais vu dans l’histoire déjà longue de la Ve République. Cette situation atypique conduit à une sorte de renversement de rôle : le sortant se présente en homme nouveau, multiplie les effets d’annonce, attaque à tout-va son challenger et bien entendu "oublie" de se référer à son bilan. En face, ledit challenger (F. Hollande) fait une campagne de sortant, annonce au compte-goutte des propositions et évite de répondre aux provocations de son principal concurrent. Si on voulait être désagréable, on pourrait dire qu’il s’agit de l’affrontement entre un « sale gosse » insolent et impétueux qui voudrait tant amener son rival dans le bac à sable face à un notaire de province qui gère, en bon père de famille, son capital électoral et qui ne veut surtout pas recevoir le moindre éclat de boue.
enger, même s’il a rattrapé une partie de celui-ci. Etre à 44 ou 45 % des voix du second tour, à cinq semaines de celui-ci, ne s’est jamais vu dans l’histoire déjà longue de la Ve République. Cette situation atypique conduit à une sorte de renversement de rôle : le sortant se présente en homme nouveau, multiplie les effets d’annonce, attaque à tout-va son challenger et bien entendu "oublie" de se référer à son bilan. En face, ledit challenger (F. Hollande) fait une campagne de sortant, annonce au compte-goutte des propositions et évite de répondre aux provocations de son principal concurrent. Si on voulait être désagréable, on pourrait dire qu’il s’agit de l’affrontement entre un « sale gosse » insolent et impétueux qui voudrait tant amener son rival dans le bac à sable face à un notaire de province qui gère, en bon père de famille, son capital électoral et qui ne veut surtout pas recevoir le moindre éclat de boue. olarisé autour de deux candidatures emblématiques, celles de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Examinons d'abord le cas de la « chef » du front national. Une opinion répandue dans le petit monde politico-médiatique voudrait que sa campagne marquerait le pas et qu'elle réaliserait une contre-performance. C'est sans doute prendre ses rêves (le mien aussi) pour la réalité. Tout cela est lié à des sondages qui, après un début de campagne tout feu tout flamme la font plafonner à 14-15 %. Prudence cependant ! Car on ne soulignera jamais assez la versalité et l’existence d’une marge d’erreur d’au moins deux points : quand on nous annonce un candidat à 13 %, il peut aussi bien être à 11 % qu’à 15 %, ce qui change tout de même les données. De plus, les sondages ont pratiquement tout le temps minimisé le score du FN.
olarisé autour de deux candidatures emblématiques, celles de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Examinons d'abord le cas de la « chef » du front national. Une opinion répandue dans le petit monde politico-médiatique voudrait que sa campagne marquerait le pas et qu'elle réaliserait une contre-performance. C'est sans doute prendre ses rêves (le mien aussi) pour la réalité. Tout cela est lié à des sondages qui, après un début de campagne tout feu tout flamme la font plafonner à 14-15 %. Prudence cependant ! Car on ne soulignera jamais assez la versalité et l’existence d’une marge d’erreur d’au moins deux points : quand on nous annonce un candidat à 13 %, il peut aussi bien être à 11 % qu’à 15 %, ce qui change tout de même les données. De plus, les sondages ont pratiquement tout le temps minimisé le score du FN.  e de Jean-Luc Mélenchon est à la fois la plus opposée qui soit à celle de Le Pen (par le choix de valeurs, par les références historiques), mais en même temps, celle qui s'alimente le plus de ce terreau de la désespérance. Là où le FN mise sur les ferments de la division et de la colère face au fatalisme de la crise, Jean-Luc Mélenchon exalte les vertus du politique pour redresser le pays. L'une joue sur le registre du « tout fout le camp », l'autre sur celui de « la volonté politique qui peut tout », mais ils sont l'un et l'autre l'expression d'une volonté de renverser la table. « Sortez-les ! », disait Mélenchon dans l'un de ses livres...
e de Jean-Luc Mélenchon est à la fois la plus opposée qui soit à celle de Le Pen (par le choix de valeurs, par les références historiques), mais en même temps, celle qui s'alimente le plus de ce terreau de la désespérance. Là où le FN mise sur les ferments de la division et de la colère face au fatalisme de la crise, Jean-Luc Mélenchon exalte les vertus du politique pour redresser le pays. L'une joue sur le registre du « tout fout le camp », l'autre sur celui de « la volonté politique qui peut tout », mais ils sont l'un et l'autre l'expression d'une volonté de renverser la table. « Sortez-les ! », disait Mélenchon dans l'un de ses livres...